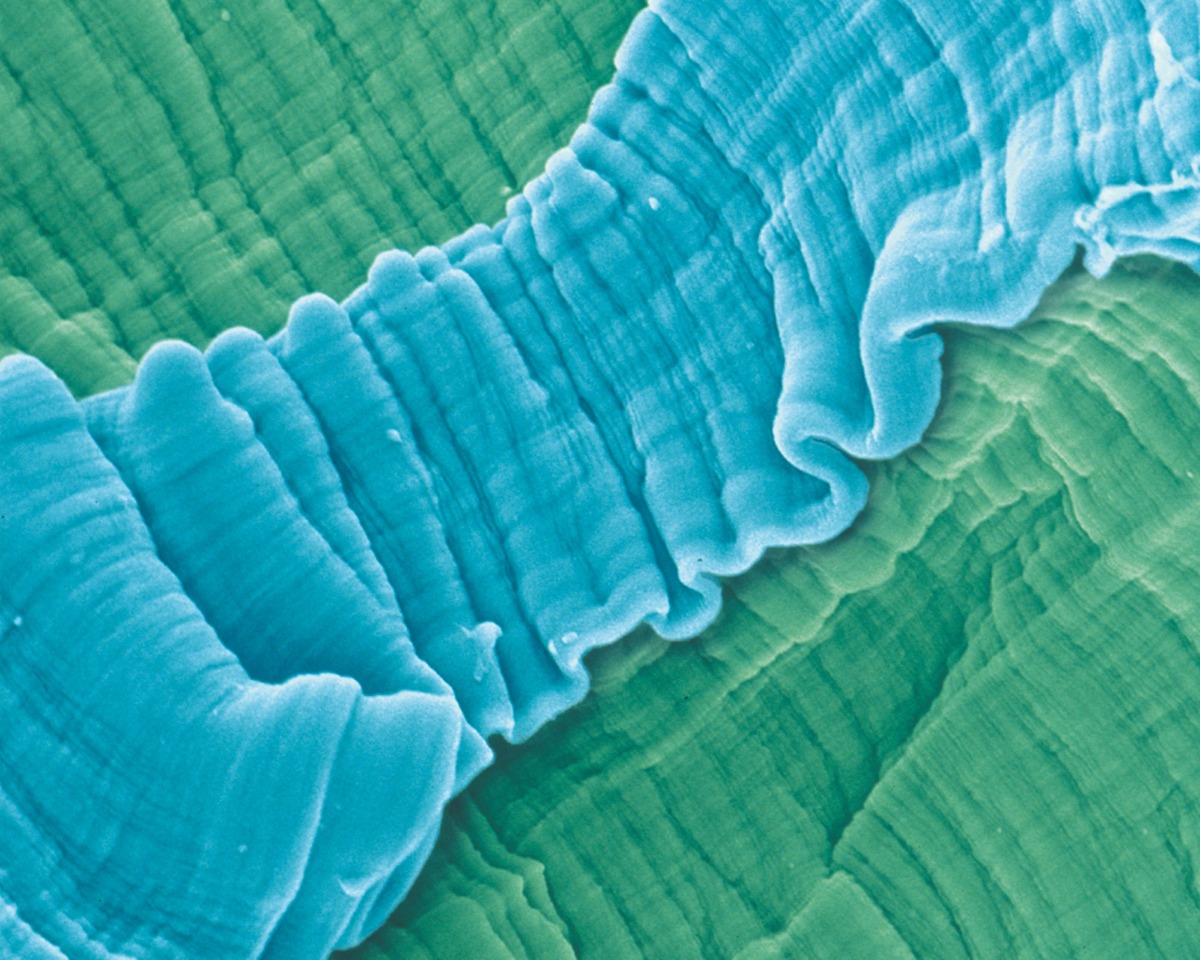Design et ingénierie :
changer de paradigme
Au sein du laboratoire de design EnsadLab, acteur du projet de phase I de l’axe Textiles, design et sciences des matériaux s’allient pour proposer de nouveaux outils de conception textile : en utilisant les changements de couleur des teintures naturelles lors de leur exposition au soleil, il est possible de concevoir des textiles faisant apparaître ou disparaître des motifs. Ce changement de paradigme proposé par la designer Lou Ramage floute les frontières entre disciplines et fait dialoguer les outils de chacune.
Par Camille Fuzier (EnsadLab), membre de l’axe Textiles
Les colorants textiles de synthèse, pétrosourcés, représentent un problème majeur de pollution des eaux usées. Leur essor s’étant inscrit dans la naissance de la société de consommation et la standardisation de la production industrielle, ce sont leurs propriétés qui valent comme norme pour les attentes actuelles d’une couleur : reproductible à l’infini, conservant teinte, saturation et luminosité dans le temps. À l’opposé, les colorants bio-sourcés (issus de végétaux, animaux, mais aussi champignons, minéraux ou bactéries), sont connus depuis des siècles mais plusieurs leviers freinent leur utilisation massive. Parmi eux, les coûts plus élevés, mais aussi leur reproductibilité, et leur solidité pour certains.
Notre recherche propose d’opérer un changement de paradigme vis à vis de ces propriétés : concevoir en utilisant la variabilité temporelle des teintures naturelles comme un atout, et non plus un défaut. On déplace la contrainte vers la propriété : on ne parle plus de décoloration, mais de couleur évolutive. L’interdisciplinarité devient alors levier de problématisation scientifique ; comment la construction de travaux à cheval entre design et sciences des matériaux force les orientations de recherche de la discipline scientifique vers de nouveaux paradigmes ?

Crédits : Freepik
Si l’on se saisit de la méthode de conception telle que proposée par la designer, plusieurs apports scientifiques sont envisageables : accélérer ou ralentir l’évolution d’un colorant, rechercher des colorants à effets par exemple. Ces pistes, les premières qui ont émergé dans le cadre de notre collaboration, témoignent d’un réflexe intellectuel qui amène la scientifique à penser en premier lieu la modification et l’optimisation de la matière pour prétendre à des propriétés qu’elle n’atteint pas sans cette étape de transformation.
Ainsi, ces premières pistes de recherche ont été exclues ; plutôt que d’essayer encore d’optimiser la fabrication, on choisit de mettre les outils scientifiques au service de la matière telle qu’elle est pour la valoriser avec ses propriétés intrinsèques. Il s’agit d’optimiser la gestion des contraintes autour de la matière, et non directement sa structure physico-chimique. Dans notre cas précis, les outils statistiques de gestion de la reproductibilité vont permettre d’exploiter des mesures colorimétriques pour permettre une visualisation, une compréhension et à terme une appropriation des variations colorées.
On ne parle plus de décoloration comme d’un défaut,
mais de couleur évolutive.
Travailler comme physico-chimiste dans une école d’art pose des problèmes d’accès à des équipements scientifiques, mais le fait de s’inscrire dans un programme interdisciplinaire national devrait pouvoir pallier à une partie de ces problèmes. L’environnement enrichissant et les modalités pédagogiques en workshop permettent de tester auprès d’étudiant.es en design une partie de nos postulats et méthodes.
Ce positionnement permet, par ailleurs, un retour vers une forme d’humilité vis-à-vis du travail millénaire de teinture naturelle qui a donné lieu à une somme conséquente de connaissances sur la fibre textile et les colorants naturels, sans pour autant régler définitivement les enjeux de reproductibilité parfaite. Se placer au niveau des contraintes à lever pour permettre une conception plus fonctionnelle et écologique, plutôt qu’au-dessus de la matière à contrôler à tout prix, nous semble plus pertinent au vu de l’urgence actuelle à repenser nos systèmes industriels. Dans le cas de recherches à l’intersection entre design et sciences des matériaux, l’intérêt apparaît rapidement : les outils des deux disciplines peuvent être mobilisés pour inscrire la démarche conjointe au plus proche de la fonctionnalité et de l’éco-conception.
Portrait de chercheuse
Camille Fuzier est docteure en physico-chimie et post-doctorante à l’EnsadLab, laboratoire de design de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs).
Après une formation d’ingénieure à l’ESPCI Paris, elle commence une thèse au LCMCP (Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris) où elle développe un biomatériau versatile et biomimétique pour servir d’alternative au cuir dans le cadre d’un contrat CIFRE avec Hermès. Durant son premier post-doctorat sur le même sujet, elle s’interroge sur les enjeux de design que pose sa recherche et rejoint ensuite le PEPR Recyclage au sein de l’EnsadLab dans le groupe Soft Matters co-dirigé par Jean-François Bassereau où elle travaille en collaboration avec Lou Ramage, doctorante en design textile.

Plus d'actualités